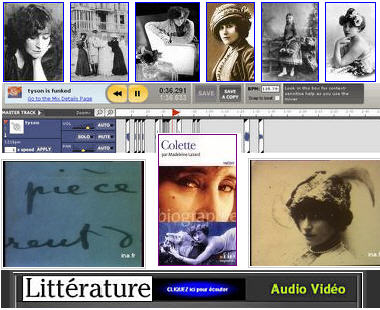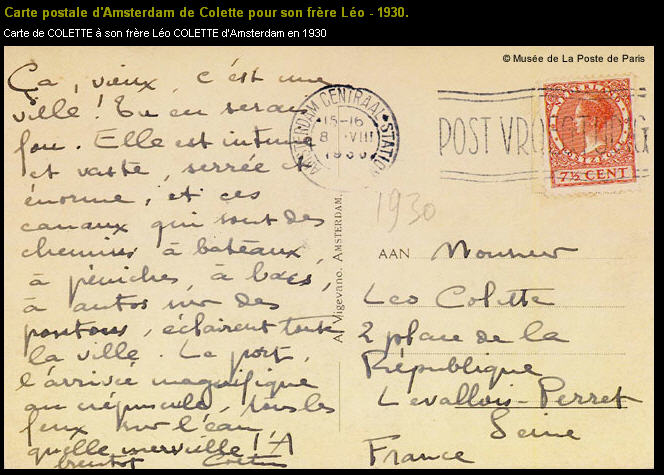La liberté, la sensualité, la provocation, tout cela existe bien sûr chez cette femme qui veut jouir de la vie chaque jour et l'exprimer par tous les pores de sa peau, par tous les trésors de sa plume. Elle se raconte sans cesse dans ses romans, ses récits, ses textes courts ; tout en jouant à cache-cache avec la réalité des faits. Les adolescentes frémissantes qu'elle dépeint dès ses premiers romans, les amoureuses vieillissantes qui cachent leur menton affaissé, ressemblent à Sidonie Gabrielle à différentes étapes de sa vie, mais elles s'échappent très vite de ce modèle pour devenir des héroïnes uniques et universelles.
L'aventure commence vers 1895, deux ans après son mariage avec Willy, premier époux de la jeune sauvageonne de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Willy le mondain, l'homme à femmes, à la fois mentor et menteur, lui fait découvrir la sensualité et la jalousie, la vie parisienne et celle du music-hall, la puissance de l'écriture et le métier de nègre.
Colette raconte dans Mes apprentissages cette première approche du romanesque... et du mensonge. « Monsieur Willy me dit un jour : Vous devriez jeter sur le papier des souvenirs de l'école primaire, je pourrais peut-être en tirer quelque chose... N'ayez pas peur des détails piquants... » Le piquant ne manquera pas avec les amours de la « dolente » Aimée soumise à la « mauvaise rousse » Mlle Sergent (dans Claudine à l'école), les caresses saphiques de Claudine avec la « troublante » Rézi (dans Claudine en ménage) sous l'oeil plus que bienveillant de Renaud, le mari de Claudine. Mais, à côté de ce libertinage appuyé qui condamnera les premiers romans aux recoins interdits des bibliothèques familiales, on découvre déjà la verve « colettienne », descriptive et généreuse lorsqu'elle parle des grands bois et des sapinières : « Je les aime pour leur odeur, pour les bruyères roses et violettes qui poussent dessous, et pour leur chant sous le vent... »
Tandis que les Claudine triomphent en librairie, Gabri - un des surnoms de Colette (qui est encore le nègre de Willy) - découvre le théâtre, le plaisir de jouer sur une scène, de faire de la pantomime, puis de s'afficher avec ses maîtresses avant d'oser demander le divorce d'avec Willy et d'entamer d'autres liaisons, féminines ou masculines. C'est cette indifférence aux réactions des uns et des autres, ce désir d'indépendance et de jouissance sans tabou, qui font plonger l'écrivain dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pages people. Dans les journaux, les échotiers retiennent la vision de la jeune femme nue lors d'un spectacle qui attire le Tout-Paris, les bagarres du public choqué lorsqu'elle embrasse une femme sur la bouche ou se montre dans les boîtes homosexuelles. Le regard ailleurs, Colette affirme : « Le mot "sens moral" n'a pas de signification pour moi. » Ces années de saltimbanque inspireront à la romancière L'Envers du music-hall, sorte de journal de bord sensible et passionnant, véritable réflexion sur un monde de nomades, difficile mais exaltant.
Mais alors que l'écrivain s'installe dans l'ampleur, la puissance d'un style, la distance parfaite, on se méfie encore de celle qui évoque les amours d'une femme mûre pour un jeune homme dans Chéri ou Le Blé en herbe. On cherche les motifs de scandale, négligeant la beauté de romans qui déploient une générosité sensuelle et jouent sur un art du portrait étincelant. « Elle se couchait miséricordieusement de bonne heure pour que Chéri, réfugié contre elle, poussant du front et du nez, creusant égoïstement la bonne place de son sommeil, s'endormît. Parfois, la lampe éteinte, elle suivait une flaque de lune miroitante sur le parquet. Elle écoutait, mêlés au clapotis du tremble et aux grillons qui ne s'éteignent ni nuit ni jour, les grands soupirs de chien de chasse qui soulevaient la poitrine de Chéri. » Dans ces quelques lignes, tirées de Chéri, on voit à quel point Colette conjugue le plaisir et la solitude, le bonheur éphémère et cette osmose avec l'humain, l'animal, le végétal, dans un superbe travail de dentellière.
Mais raconter les choses ordinaires de la vie, avoir envie d'un homme comme on désire une miche de pain, parler des plaisirs saphiques et de la fatigue des corps après l'amour, tout cela fait frissonner les hypocrites. Et la romancière en rajoute, s'amuse à choquer, glisse toujours un brin d'humour et de volupté : « Léa souriait et goûtait le plaisir d'avoir chaud, de demeurer immobile et d'assister aux jeux des deux hommes nus, jeunes, qu'elle comparait en silence: "Est-il beau, ce Patron ! Il est beau comme un immeuble. Le petit se fait joliment. Des genoux comme les siens, ça ne court pas les rues, et je m'y connais. Les reins aussi sont, non, seront merveilleux... Et l'attache du cou, une vraie statue. Ce qu'il est mauvais ! Il rit, on jurerait un lévrier qui va mordre..." » (Chéri).
Il n'est pas étonnant que le féminisme ait trouvé dans son oeuvre nombre de résonances... Jamais l'auteur de L'Entrave ne cessera de prôner la liberté de la femme : liberté physique, droit de choisir et, surtout, indépendance financière. Si Colette décide d'entrer dans le monde du music-hall, du journalisme, du théâtre, c'est aussi, peut-être même d'abord, pour s'assumer financièrement, ne rien devoir à ceux qui partagent sa vie, se libérer de toutes les entraves de la vie quotidienne.
C'est lorsqu'elle se penche sur son enfance, sa famille, sa mère Sido en particulier, qu'elle obtient sa vraie reconnaissance littéraire. Les intellectuels célèbrent enfin son talent, la préférant fille dévouée au souvenir familial qu'amoureuse sans contraintes. Elle nous parle alors de femmes courageuses et pragmatiques, héroïnes de chaque jour, capables de pleurer de joie devant un rosier cuisse-de-nymphe et d'évoquer froidement les effets de l'âge sur des jambes alourdies et des rhumatismes déformants. Mais il lui aura fallu du temps pour oser écrire sur Sido. Elle commence à l'évoquer dans La Maison de Claudine en 1922 avant de la célébrer dans La Naissance du jour six ans plus tard. Avec cette mère magnifique, Colette ouvre la porte d'un monde de sensations et de lyrisme. « Puissé-je n'oublier jamais que je suis la fille d'une telle femme qui penchait, tremblante, toutes ses rides éblouies entre les sabres d'un cactus sur une promesse de fleur, une telle femme qui ne cessa elle-même d'éclore, infatigablement, pendant trois quarts de siècle... » (La Naissance du jour).
Si les Claudine racontaient l'enfance de Colette, elles n'étaient qu'une ébauche pour l'écrivain, qui avait tendance à renier ces premiers livres écrits grâce et avec Willy, son mari-pygmalion. Parler de Sido, raconter cette mère terrienne lui permet en revanche toutes les grâces. Colette fait sortir de son écriture les parfums et les couleurs. On entend sa voix et celle de sa mère, on marche dans le jardin, on écoute les gouttes de pluie sur le toit et le frôlement des pattes de chats sur les dalles de la cuisine. Le village peut renaître, voici le paradis de l'enfance et cette envie d'y retourner encore et encore pour entendre Sido crier devant la maison : « Mais où sont les enfants ! » « Que j'aurais voulu offrir, à cet ongle dur et bombé, apte à couper les pétioles, cueillir la feuille odoriférante, gratter le puceron vert, et, interroger dans la terre les semences dormantes, que j'aurais voulu offrir mon propre miroir de naguère ; la tendre face à peine virile qui me rendait embellie, mon image ! J'aurais dit à ma mère : "Vois. Vois ce que je fais. Vois ce que cela vaut..." » (La Naissance du jour).
Comme le raconte Michel del Castillo dans son ouvrage Colette, une certaine France, Sidonie Gabrielle Colette eut toujours l'ambition de devenir « quelqu'un », cet écrivain qu'elle portait en elle. Elle y parviendra, honorée par les plus grands auteurs, placée à l'égal de Gide ou de Mauriac, après avoir été traitée de frivole uniquement tournée vers l'hédonisme. « Colette peint un monde d'avant le péché, d'avant la culpabilité et la honte, où l'homme et l'animal communient dans une identique recherche du plaisir », évoque Michel del Castillo.
Devenue la dame du Palais-Royal, visitée comme une star, adorant distiller ses paroles, Colette peaufine son image d'auteur sur piédestal, reconnu par ses pairs. On a envie d'oublier ces années trop solennelles, ces obsèques nationales, ces légions d'honneur. Colette reste une enfant de Saint-Sauveur, une gourmande de Saint-Tropez, une rêveuse de Châtillon-Coligny, la main tendue vers une pêche mûre à point, le pied nu dans le sable, un chat qui l'attend sous l'auvent de roseaux, une promesse de fleur... « Colette, c'est la vie, disait Le Clézio, on lit Colette et on oublie les mots, on oublie la barrière du langage écrit, l'auteur, la culture... Ce miracle rejoint un autre miracle, celui du temps de l'enfance. »
Télérama n° 2847 - 7 août 2004